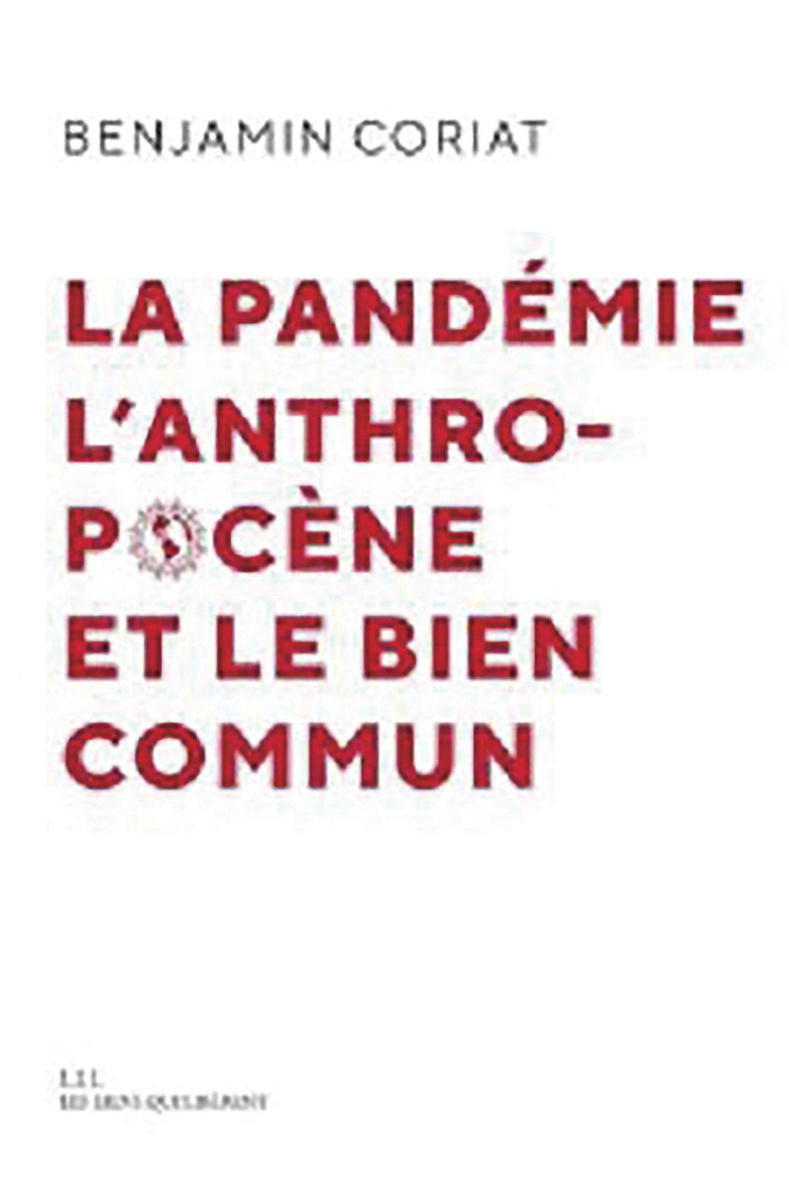"C eci n'est pas un livre de recette", avertit d'emblée Benjamin Coriat , "il ne prétend pas donner de solution miracle, mais il invite à prendre de la hauteur face à la réalité."
Mais commençons par comprendre ce qu'est l'anthropocène. L'auteur le définit comme suit: Il s'agit des activités humaines, économiques et industrielles si importantes qu'elles perturbent les équilibres écosystémiques. C'est le mot imposé pour définir l'âge, dans lequel le modèle de développement est devenu une telle force qu'il est à l'origine du dérèglement climatique.
Benjamin Coriat explique que tous les virus, le Sars-Cov 1, le Sars-Cov 2, ou encore les Mers, viennent d'une même famille, les zoonoses, des maladies provoquées par des virus présents chez l'animal. Et ces zoonoses sont en pleine expansion. Plusieurs rapports de l'OMS faisaient d'ailleurs état de la venue d'une grande infection compte tenu des bilans dressés de l'émergence et de la diffusion de zoonoses. Les changements dans les écosystèmes sont la cause première de cette diffusion: près d'un quart des épidémies y trouvent d'ailleurs leurs origines.
L'auteur prend, en exemple, l'origine de l'expansion du paludisme liée à la déforestation de l'Amazonie. L'activité des hommes au coeur des forêts amazoniennes les met en contact avec des espèces animales et le foyer des virus qu'ils hébergent. Plus au nord, la fonte du permafrost en Antarctique est également une menace sérieuse, libérant des pathogènes oubliés.
Plus nous déforestons pour planter une monoculture de soja transgénique en Amérique du Sud ou d'huile palme au Congo, plus nous détruisons d'écosystèmes et plus nous multiplions les zones de contacts qui donnent accès aux zoonoses, défend Benjamin Coriat. Mais à côté de la destruction de la biodiversité par l'extractivisme, il existe une autre raison de la diffusion des zoonoses: les marchés et les trafics d'animaux sauvages. Ils sont souvent tenus par des cartels criminels qui exportent leurs animaux ou leurs organes de manière illégale.
Face à ce constat, deux solutions aux antipodes
Face à ce constat, l'auteur fait le point sur quelques postures qui, selon lui, sont de faux semblants. Il s'agit de la géoingénierie, qui pense venir à bout du virus par la technologie en prétendant combattre l'excès par un nouvel excès, et à son opposé, la théorie de l'effondrement.
La géoingénierie n'intervient pas sur les causes du réchauffement climatique mais sur leurs effets. Les solutions proposées consistent à manipuler le climat en ajoutant des produits chimiques dans les océans et l'atmosphère, alors qu'on ignore les effets à long terme.
L'auteur cite en exemple différentes recherches qui seraient en cours tel que le déversement de sulfate de fer dans l'océan, afin de favoriser le développement d'algues planctoniques qui pourraient stocker d'immenses quantités de carbones, ou encore l'injection de chaux dans les eaux douces pour éviter une variation du PH et capturer plus de CO2. Ainsi, tout pourrait continuer dans nos manières de produire. Une injection qui pourrait en réalité détruire des espèces qui ont besoin d'un PH acide, sans oublier toutes les autres espèces qui en dépendent et qui seraient éradiquées par la même occasion, chamboulant tout l'écosystème.
Aux antipodes de la technologie, nous retrouvons les convaincus de l'effondrement. Pour eux, il faut se préparer à vivre en petites communautés, en marge du capitalisme. Benjamin Coriat cite la théorie d'Ana Tsing qui consiste à s'adapter au courant d'épidémies. Elle prend l'exemple de la cueillette du champignon Matsutake, un champignon qui pousse là où les forêts sont détruites, qui permettrait de subvenir à ses besoins et vivre en autarcie. En quelque sorte un symbole de survie.
Retour aux biens communs
Les océans et l'atmosphère sont souvent des lieux de non-droit, des biens communs sur lesquels aucune gouvernance véritable ne devrait s'exercer, poursuit Benjamin Coriat. La porte est donc ouverte à des projets non contrôlés. Selon lui, il faut repenser l'action publique et refaire de véritables biens communs où se nourrir, se loger, se déplacer, ou encore s'éduquer seraient les pôles d'une nouvelle économie du bien commun.
Sa réflexion tourne autour de la gouvernance "commune" des biens communs et de la démocratie participative. Il prend l'exemple de la convention citoyenne pour le climat de Cyril Dion avec 150 citoyens tirés au sort. Une convention qui aura au moins eu le mérite d'être essayée, précise l'auteur.
En réalité, la démocratie participative avec tirage au sort a déjà été mentionnée il y a quelques années, dans l'ouvrage de l'essayiste belge, David Van Reybrouck Contre les élections. Un essai qui a été traduit dans une vingtaine de langues et a été une source d'inspiration dans de nombreux pays. Plusieurs initiatives belges de collectifs ont d'ailleurs vu le jour à Eupen, Louvain-la-Neuve et Bruxelles, entre autres 3.
Cette démocratie participative est-elle une utopie? Ou une source d'inspiration pour repenser notre démocratie? Le futur nous le dira.
1. La pandémie, l'anthropocène et le bien commun, Benjamin Coriat, aux Editions Les Liens qui Libèrent
2. Le terme d'extractivisme, ne définit pas le seul fait d'extraire, mais aussi tout ce qui en dépend à savoir les voies d'évacuation, de transport et la circulation mondialisée (routes, voies ferrées, pipelines, pistes d'atterrissage, navires, etc.)
3. Imagine, Demain Le Monde N°132