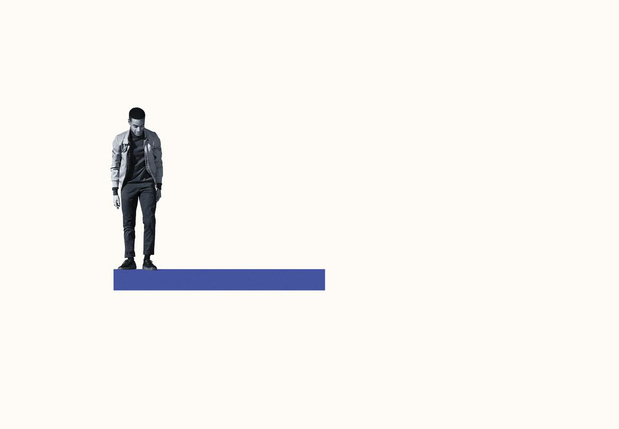Le Groupe cdH a proposé une résolution visant à prévenir les suicides et les tentatives de suicide dans le contexte de fragilisation de la santé mentale causé par la crise sanitaire du Covid-19. La proposition, débattue la semaine dernière en Commission santé wallonne, a débouché sur un débat riche autour des moyens - trop faibles - mis sur la table pour la santé mentale en Belgique.
Parlons d'abord de la thématique abordée: le suicide. La pandémie augmente-t-elle le risque suicidaire? S'il est compliqué de répondre de manière catégorique, le Pr Vincent Lorant (Institut de recherche santé et société de l'UCLouvain) rapporte que plusieurs études se sont penchées sur le sujet. "La conclusion est qu'il n'y a pas eu d'augmentation nette et systématique du taux de suicide dans les pays développés. Grosso modo, dans la majorité des cas, on observe un nombre de suicides inférieur au nombre attendu."
Cependant, notre pays fait face à un taux de suicide pour 100.000 habitants historiquement élevé. "Depuis les 20-30 dernières années, la Belgique est passée d'un taux de suicide moyen à un taux parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, et en particulier en comparaison avec nos voisins." À noter que la Wallonie a le taux de suicide le plus élevé des trois régions du pays. "Ce taux de suicide diminue, mais il reste plus élevé que les deux autres régions du pays."
La proposition du cdH s'inscrit dans cette logique. Elle vise à "augmenter les mesures de prévention du suicide et à instaurer un monitoring précis du phénomène. Elle rappelle l'importance de travailler avec les acteurs clés que sont la presse et la première ligne de soin. Pour garantir la réussite de la promotion de la santé mentale pour tous, elle plébiscite une approche transversale qui tient compte des inégalités sociales."
Lien entre suicide et santé mentale
Dans les grandes lignes, tous les acteurs politiques wallons sont d'accord sur la nécessité d'améliorer la prise en charge du suicide, mais également de la santé mentale en général. "Le suicide a des liens très étroits avec la question de la santé mentale", note Marie Lambert, codirectrice du Centre de référence en santé mentale (Crésam). "Je dirais notamment que la pathologie mentale est un des facteurs de risque les plus importants en matière de suicide. Tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la santé mentale de la population est potentiellement un facteur de protection par rapport au passage à l'acte suicidaire."
"Le suicide est un indicateur de vulnérabilité du système de santé mentale", renchérit le Pr Lorant . "Quand le suicide augmente, cela veut dire que notre système de santé mentale n'est pas performant. Je plaide très fortement pour rapprocher ces deux secteurs."
Et dire que notre système de santé mentale n'est pas performant est un euphémisme. L'étude Cofi, menée conjointement avec l'Italie, l'Allemagne et la Pologne, a mesuré le nombre de semaines d'attente pour un patient sortant de l'hôpital psychiatrique pour obtenir une consultation. Si le délai est de trois semaines en Italie, en Angleterre et en Allemagne, il est de sept semaines en Belgique. "Nous avons un souci avec la continuité à la sortie de l'hôpital psychiatrique."
Le Pr Lorant note également un déficit d'intégration des patients psychiatriques au sein de notre société. Selon des chiffres Sciensano, plus d'un patient en grande souffrance psychiatrique sur deux est exclu du marché du travail. "C'est inacceptable. Nous devons travailler sur l'intégration des patients psychiatriques. Ce dont nous manquons cruellement en Région wallonne, c'est d'une grande campagne de déstigmatisation de la santé mentale, de manière à ce que tous ces patients puissent retrouver leur place dans la société."
Une approche globale de santé mentale
Vincent Lorant estime que le suicide et la santé mentale sont "sans doute un "case studies" de la fragmentation des compétences de santé. On pourrait réduire la fragmentation des compétences qui tournent autour de la santé mentale et du suicide au sein de notre Région."
Tous les acteurs du débat s'accordent pour dire que la première ligne aura un rôle à jouer. Mais encore faut-il qu'elle ait les ressources nécessaires. "Depuis le début de la crise, nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des acteurs de première ligne qui sont démunis, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin d'informations sur la santé mentale", explique Marie Lambert, pour qui une solution serait une approche territoriale. "Cela nous semble vraiment intéressant dans la mesure où des ponts sont déjà? créés. Cela facilite évidemment les collaborations face à des situations problématiques." Un point sur lequel rebondit Frédérique van Leuven, psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage. "Il faut renforcer ces liens entre psychiatres et généralistes, qui sont souvent beaucoup trop écartés les uns des autres."
Outre le renforcement de la première ligne, il faut également veiller à une offre de soins en santé mentale suffisante. "Les services sont saturés. Si l'implication des premières lignes permet déjàd'avoir une première écoute, de parfois endiguer la crise, il n'en reste pas moins que certaines situations doivent pouvoir trouver des réponses au sein d'un service spécialisé en santé mentale. On ne peut que souligner l'importance du renforcement des services existants via les moyens qui ont été dégagés dans le cadre de cette pandémie par la Wallonie. Nous ne pouvons qu'encourager la pérennisation de ces moyens."
Vincent Lorant conclut en jetant un pavé dans la mare. "La Région wallonne n'a-t-elle pas délégué sa stratégie au prestataire? Une stratégie dans le domaine de la santé mentale ou de la prévention du suicide doit être ramenée au niveau de la gouvernance principale de la Région wallonne, pas au niveau d'un prestataire. La Région wallonne se fonde très largement sur les opérateurs pour acquérir son expertise et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Où la Région wallonne acquiert-elle son expertise scientifique de haute qualité dans le domaine de la recherche sur les services de santé mentale? Je plaide en faveur d'un financement d'un programme de recherche en matière de prévention du suicide, en matière d'organisation des services de santé mentale pour pouvoir alimenter cette expertise dans les dix années à venir, afin de pouvoir travailler ensemble à développer une coalition de plaidoyer."
Parlons d'abord de la thématique abordée: le suicide. La pandémie augmente-t-elle le risque suicidaire? S'il est compliqué de répondre de manière catégorique, le Pr Vincent Lorant (Institut de recherche santé et société de l'UCLouvain) rapporte que plusieurs études se sont penchées sur le sujet. "La conclusion est qu'il n'y a pas eu d'augmentation nette et systématique du taux de suicide dans les pays développés. Grosso modo, dans la majorité des cas, on observe un nombre de suicides inférieur au nombre attendu."Cependant, notre pays fait face à un taux de suicide pour 100.000 habitants historiquement élevé. "Depuis les 20-30 dernières années, la Belgique est passée d'un taux de suicide moyen à un taux parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, et en particulier en comparaison avec nos voisins." À noter que la Wallonie a le taux de suicide le plus élevé des trois régions du pays. "Ce taux de suicide diminue, mais il reste plus élevé que les deux autres régions du pays."La proposition du cdH s'inscrit dans cette logique. Elle vise à "augmenter les mesures de prévention du suicide et à instaurer un monitoring précis du phénomène. Elle rappelle l'importance de travailler avec les acteurs clés que sont la presse et la première ligne de soin. Pour garantir la réussite de la promotion de la santé mentale pour tous, elle plébiscite une approche transversale qui tient compte des inégalités sociales."Dans les grandes lignes, tous les acteurs politiques wallons sont d'accord sur la nécessité d'améliorer la prise en charge du suicide, mais également de la santé mentale en général. "Le suicide a des liens très étroits avec la question de la santé mentale", note Marie Lambert, codirectrice du Centre de référence en santé mentale (Crésam). "Je dirais notamment que la pathologie mentale est un des facteurs de risque les plus importants en matière de suicide. Tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la santé mentale de la population est potentiellement un facteur de protection par rapport au passage à l'acte suicidaire." "Le suicide est un indicateur de vulnérabilité du système de santé mentale", renchérit le Pr Lorant . "Quand le suicide augmente, cela veut dire que notre système de santé mentale n'est pas performant. Je plaide très fortement pour rapprocher ces deux secteurs."Et dire que notre système de santé mentale n'est pas performant est un euphémisme. L'étude Cofi, menée conjointement avec l'Italie, l'Allemagne et la Pologne, a mesuré le nombre de semaines d'attente pour un patient sortant de l'hôpital psychiatrique pour obtenir une consultation. Si le délai est de trois semaines en Italie, en Angleterre et en Allemagne, il est de sept semaines en Belgique. "Nous avons un souci avec la continuité à la sortie de l'hôpital psychiatrique."Le Pr Lorant note également un déficit d'intégration des patients psychiatriques au sein de notre société. Selon des chiffres Sciensano, plus d'un patient en grande souffrance psychiatrique sur deux est exclu du marché du travail. "C'est inacceptable. Nous devons travailler sur l'intégration des patients psychiatriques. Ce dont nous manquons cruellement en Région wallonne, c'est d'une grande campagne de déstigmatisation de la santé mentale, de manière à ce que tous ces patients puissent retrouver leur place dans la société."Vincent Lorant estime que le suicide et la santé mentale sont "sans doute un "case studies" de la fragmentation des compétences de santé. On pourrait réduire la fragmentation des compétences qui tournent autour de la santé mentale et du suicide au sein de notre Région."Tous les acteurs du débat s'accordent pour dire que la première ligne aura un rôle à jouer. Mais encore faut-il qu'elle ait les ressources nécessaires. "Depuis le début de la crise, nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des acteurs de première ligne qui sont démunis, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin d'informations sur la santé mentale", explique Marie Lambert, pour qui une solution serait une approche territoriale. "Cela nous semble vraiment intéressant dans la mesure où des ponts sont déjà? créés. Cela facilite évidemment les collaborations face à des situations problématiques." Un point sur lequel rebondit Frédérique van Leuven, psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage. "Il faut renforcer ces liens entre psychiatres et généralistes, qui sont souvent beaucoup trop écartés les uns des autres." Outre le renforcement de la première ligne, il faut également veiller à une offre de soins en santé mentale suffisante. "Les services sont saturés. Si l'implication des premières lignes permet déjàd'avoir une première écoute, de parfois endiguer la crise, il n'en reste pas moins que certaines situations doivent pouvoir trouver des réponses au sein d'un service spécialisé en santé mentale. On ne peut que souligner l'importance du renforcement des services existants via les moyens qui ont été dégagés dans le cadre de cette pandémie par la Wallonie. Nous ne pouvons qu'encourager la pérennisation de ces moyens."Vincent Lorant conclut en jetant un pavé dans la mare. "La Région wallonne n'a-t-elle pas délégué sa stratégie au prestataire? Une stratégie dans le domaine de la santé mentale ou de la prévention du suicide doit être ramenée au niveau de la gouvernance principale de la Région wallonne, pas au niveau d'un prestataire. La Région wallonne se fonde très largement sur les opérateurs pour acquérir son expertise et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Où la Région wallonne acquiert-elle son expertise scientifique de haute qualité dans le domaine de la recherche sur les services de santé mentale? Je plaide en faveur d'un financement d'un programme de recherche en matière de prévention du suicide, en matière d'organisation des services de santé mentale pour pouvoir alimenter cette expertise dans les dix années à venir, afin de pouvoir travailler ensemble à développer une coalition de plaidoyer."